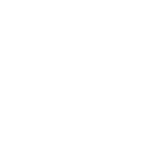Des nouvelles de Rudy Gobert : « Les gens imaginent que la NBA, c’est tranquille. »
La caisse de basse du Range Rover cogne jusque dans l'estomac des passagers. « Shape on you » d'Ed Sheeran, Nekfeu qui gueule son « Saturne » : « Dans la mère à Donald Trump / J'ai des valeurs, je suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent /Fuck le succès, je veux rester dans la lumière en l'éteignant » Aucun morceau ne parvient jusqu'à son terme et, parfois, c'est aussi bien… Rudy Gobert, alias « Gobzilla », conduit vite et bien, le toit légèrement ouvert, tenant le volant de la main gauche et l'iPhone de la droite, changeant de chanson toutes les trente secondes. On dit que si les rues de Salt Lake City, capitale de l'Utah, siège mondial de l'Église mormone et temple des basketteurs des Jazz, sont aussi larges, c'est parce qu'elles ont été dessinées pour permettre à un chariot tiré par quatre bœufs de faire demi-tour.
Les urbanistes du XIXe siècle (la ville fut fondée en 1847 par 148 pionniers mormons) ne se doutaient pas qu'un jour, ils faciliteraient la vie dorée d'une star française de la NBA filant à travers la cité, doublant par la gauche et la droite, passant devant le stade olympique des Jeux d'hiver de 2002 pour vite gagner l'Arena à bord de son superbe 4×4 anglais tout de cuir revêtu. Le pilote porte beau : costume brun taillé sur mesure, belle chemise à fins carreaux noirs et blancs, élégantes chaussures de cuir, un petit diamant à chaque oreille, une fine épée en pendentif. À l'arrivée aux vestiaires, en ce jour de match contre les Wizards de Washington, Rudy Gobert est le plus élégant de tous. Il faut dire qu'il n'est pas n'importe qui. Sa photo trône, gigantesque, au-dessus de l'entrée principale du stade ; c'est son visage qui apparaît sur les publicités diffusées sur les écrans géants avant que le match ne débute ; son nom et son numéro, le 27, qui envahissent, entre deux achats de tonneaux de pop-corn, les boutiques de produits dérivés et font la fortune des vendeurs et du club… Un des commerçants l'assure : « Il n'y en a qu'un à pouvoir rivaliser avec Rudy, c'est Gordon Hayward ! » Hayward, son ancien coéquipier, le beau blond à la gueule de mannequin. Mais à Salt Lake City, alias SLC, Rudy Gobert est le king. Celui que les dirigeants des Utah Jazz ont choisi de « drafter » (recruter) en 2011 et qu'ils ont voulu garder à prix d'or.
Cette année, le jeune homme, né à Saint-Quentin en 1992, est devenu le sportif français le mieux payé de l'histoire du sport. Plus que Tony Parker, qu'un pilote de Formule 1, qu'une star du football. Pour avoir accepté de prolonger son contrat pour quatre années supplémentaires avec les Jazz, Gobert va toucher 102 millions de dollars, environ 92 millions d'euros. Salaire annuel : 25,5 millions de dollars, soit plus encore que l'autre Frenchy Nicolas Batum et son contrat pharaonique avec les Charlotte Hornets. Par jour, cela lui fait 62.000 euros.
La vie king size
Tout est disproportionné dans cette vie de star de la NBA, même dans la très sage Salt Lake City. Le salaire et le contrat de Rudy Gobert, sa taille (2,16 m), ses chaussures (pointure 53), la carrure de ses beaux costumes, sa maison. On y parvient en roulant un quart d'heure depuis le centre-ville, en prenant la direction d'une des montagnes de l'Utah qui l'encerclent. Entrée privative, très belles demeures élégantes, pas un bruit sauf celui des grosses cylindrées qui roulent au pas. Un entre-soi riche, calme, au milieu de la verdure. La demeure de Rudy a des allures de musée d'art contemporain : froide, sobre, chic et immense (1 000 m2), sur trois niveaux que l'on gagne en grimpant puis descendant de petits escaliers. Le hall d'entrée et la salle de billard qui le jouxte composeraient à eux deux un confortable appartement parisien.
Le maître des lieux surgit depuis la cuisine qui, avec ses trois plans de travail, est digne de celle d'un grand restaurant. T-shirt, short et chaussettes orange. On a beau soi-même atteindre le 1,90 m sur la pointe des pieds, on se sent ridiculement minuscule à son côté. Il s'excuse : « J'arrive dans quelques instants, je finis mon rendez-vous. » Il rejoint dans la cuisine les deux occupantes de la Porsche blanche garée devant la maison, deux architectes d'intérieur à qui il a demandé de décorer et meubler cette demeure achetée au plus riche concessionnaire automobile de la région. Puis il nous rejoint, avale un pain au chocolat et un chocolat chaud que sa mère, qui vit plusieurs mois de l'année ici, vient de lui apporter. La visite du palais peut commencer. « Ici, je vais faire installer une salle de jeux vidéo. Là, une salle de sport. Ici, un dressing, une chambre, là une autre, et encore une autre… On va refaire cette salle de bains, c'est trop petit pour moi, je ne peux pas y rentrer ! » Chaque pièce a la taille d'un studio. Sans lui, on se perdrait. On échouerait dans ce dressing, à compter les immenses paires de chaussures de sport sagement rangées, les maillots du PSG, les costumes et les chemises alignés, pliés ou reposant sur des cintres. Dehors, le terrain de basket privatif jouxte un court de tennis qu'il va transformer en piscine. Le terrain est vaste, arboré, et mord presque sur la montagne. « Parfois, le soir, tu vois passer des daims. » Des élans, des pumas et des renards peuplent également les environs. Tout est parfaitement et spectaculairement silencieux. Gobzilla est le plus jeune habitant de ce havre de paix, à mille lieues de ce qu'il a toujours connu. Quoi de plus opposés que la cité HLM de Picardie où il a grandi et cette sublime villa américaine ? Sans tomber dans le misérabilisme, le no 27 des Jazz revient de loin. Il a grandi sans son père, Rudy Bourgarel, autre géant (2,13 m), une vingtaine de sélections en équipe de France et un passage avorté en NBA. Il vit en Guadeloupe, Rudy lui rend visite de temps en temps et l'aide à subvenir à ses besoins. Avec sa mère, c'est une autre histoire. Joviale, grande gueule, drôle, Corinne Gobert passe une grande partie de son temps à SLC. Elle a élevé seule ses trois enfants : Vanessa, qui envisage de rejoindre Salt Lake pour y ouvrir une boulangerie ; Romain, trader à New York, et Rudy. « Je n'ai pas honte de le dire, confie-t-elle entre deux éclats de rire. À certains moments, j'ai dû aller aux Restos du cœur pour nourrir mes enfants. »
« Rudy, tiens-toi mieux ! »
Ancienne coiffeuse et esthéticienne, elle se souvient des soins qu'elle prodiguait au black pour quelques euros, histoire de pouvoir s'en sortir. Rudy n'a rien oublié. « J'ai grandi dans un milieu très modeste. Mais je me suis toujours satisfait des choses simples. J'étais content, j'avais ma petite Game Boy, une bonne éducation… Ma mère s'est toujours sacrifiée pour nous, l'éducation a été la clé de tout. Mais quand tu es un gamin, que tu grandis et que tu es loin d'avoir tout ce que tu voudrais avoir, tu as faim. Et cette faim ne disparaît jamais. J'étais petit, je débutais le basket et je voyais la maison de Tony Parker à la télé. Ça me faisait envie. » Aujourd'hui, la sienne rend les autres jaloux.
Il se confie, affalé sur son immense canapé en L, dont il occupe toute la partie principale. Il n'a pas l'air toujours très concerné ni concentré, se révèle un client difficile à qui il faut souvent arracher les confidences. Il est allongé comme un ado, tourne le dos, se redresse, se retourne sur lui-même, s'assied, se rallonge… Sa mère l'engueule : « Rudy, tiens-toi mieux ! Enfin, on ne parle pas aux gens comme ça ! Rudy !!! Assieds-toi ! » Il ne l'écoute pas, il est trop grand, il a 25 ans et postule au poste de meilleur défenseur de la NBA. Au mois de mai, il a même figuré dans la deuxième All-NBA Team, manquant le Top 5 pour trois petits votes. Et il est le premier joueur de la NBA à finir une saison dans le trio de tête des statistiques en attaque et en défense. Enfant, il ne tenait déjà pas en place. Sa mère l'inscrit au judo, au karaté, à l'athlétisme et à la boxe. Un jour, pour s'amuser, il tente de décapiter un dragon en plastique – « Un requin ! » assure sa mère – à l'aide d'un cutter. La main est entaillée sur cinq centimètres, impossible de continuer à boxer. Un médecin lui recommande d'essayer le basket. Vu la taille à venir du gamin, le conseil s'avère pertinent. Il est en 6e. « J'avais toujours mon ballon avec moi. Il y avait un panier accroché dans le jardin de la grand-mère d'un copain, j'y jouais tout le temps. J'avais un bon feeling. » Il se voit déjà en NBA : « Je n'étais jamais le meilleur mais j'avais une volonté de fou. J'ai toujours su que j'irai en NBA, mais je ne savais pas que je deviendrai l'un des meilleurs défenseurs. »
Il postule à l'Insep, le temple du sport français, en 2007. Il est recalé. « J'ai reçu la lettre, je l'ai lue et là, je te jure, j'ai pleuré. J'avais la rage, mon plan de carrière passait par l'Insep ! » Et puis, quoi ? Est-ce la providence ? Le même jour, le club de Cholet l'appelle et lui propose de le recruter. Sous-préfecture de 54 000 habitants, dans le Maine-et-Loire. Ça ne vous fait peut-être pas rêver mais en basket, Cholet rappelle Auxerre ou Nantes jadis pour le football : un grand club formateur, capable d'ouvrir à ses jeunes talents de très grandes portes. À 15 ans, Rudy se retrouve à 550 km de la maison. Il perfectionne son anglais en vue de la NBA et décroche le bac S tout en s'entraînant plus encore que les autres, les matins avant les cours, le soir après… « Ce fut de belles années même si tu es un peu livré à toi-même alors que tu n'es qu'un gamin. Tu es obligé de mettre toutes les chances de ton côté, parce que tu sais ce que tu veux. Les mecs étaient tous plus costauds que moi, mais je m'en foutais ! » On ose la question : certes, il a beaucoup, beaucoup travaillé et continue de le faire. Mais se considère-t-il comme un surdoué ? La réponse fuse, foncièrement immodeste mais sincère : « Oui, bien sûr ! Ça a toujours été facile, même à l'école ! »
Répondre (et sourire) à la presse
À Cholet, Thierry Chevrier, aujourd'hui directeur du club, se souvient d'avoir dit aux recruteurs : « “Ce môme, on peut y aller les yeux fermés. Il va se passer quelque chose !” Il avait un don. Une assurance et un potentiel incroyables, un physique hors du commun et une volonté folle. Il payait même une cuisinière, Maria, pour lui préparer les repas les plus diététiques et équilibrés qui soient, toujours dans la perspective d'être drafté. » Il gagne alors 2 000 euros par mois. Quand il est venu au printemps à Paris, Rudy a été obligé d'embaucher des gardes du corps. « T'es un mec qui vaut 102 millions de dollars, tu peux pas te balader comme ça dans la rue, tranquille ! » l'a prévenu un de ses agents. Ils sont trois à travailler aujourd'hui pour Rudy Gobert. Jérémy Medjana s'occupe de ses finances. Bouna Ndiaye (l'agent d'Evan Fournier et de Nicolas Batum, l'autre Français le mieux payé de l'histoire) gère l'aspect sportif, notamment les contrats. Enfin, Kalem Mauvois traite des relations avec la presse : « Rudy s'est toujours souvenu de ses rares échecs et des revanches à prendre, explique-t-il, comme ce jour où il n'a pas été admis à l'Insep. » Mais à chaque fois qu'une porte s'est fermée, ce fut la même réaction : « Ah ouais ? Vous ne voulez pas de moi ? Je vais vous montrer… Vous n'auriez pas dû me sous-estimer ! » Rudy tourne autour de la table basse posée devant l'immense cheminée. « J'ai toujours aimé pouvoir fermer tôt ou tard la bouche des mecs qui m'ont critiqué ou n'ont pas cru en moi. Aujourd'hui encore. Les gens imaginent que la NBA, c'est tranquille, que t'as juste à jouer à la baballe pour empocher des millions. Je ne me plaindrai évidemment jamais de mon sort, mais ils n'ont pas idée des sacrifices. »
Il est 10 heures du matin, c'est jour de match, comme 82 fois par an en NBA, sans compter les play-offs. Un duel tous les deux ou trois jours à travers un pays grand comme un continent. Les Jazz sont à l'entraînement. Posé au bord de l'autoroute et entouré de concessionnaires automobiles, le gymnase est immense, propre comme un sou neuf, jouxté par une immense salle de musculation. Un par un, quelques joueurs, suivis du coach, traversent le parquet et se posent contre un mur pour quinze minutes d'interview. Il en sera de même au moment du match : libre accès aux vestiaires pour la presse avec obligation pour les joueurs de répondre. Pas question de se dérober ou de faire la tronche comme les divas du championnat de France de foot. Le no 27 s'avance nonchalamment, en sifflotant. 27, comme le jour où il a été drafté à Brooklyn par les Jazz, le 27 juin 2013. 27, comme son classement dans les 30 meilleurs ce jour-là. Il est littéralement gigantesque, encore plus quand il écarte les bras : son envergure atteint 2,36 m, un record que seul le Serbe Boban Marjanovic, le plus grand basketteur actuel en NBA (2,21 m) peut lui disputer. Pour le journaliste Jody Genessy, du Deseret News : « L'envergure de Gobert dépasse la longueur de la plupart des voitures françaises ! » Mais ce corps immense s'avère fragile : tous les ans, vers la fin de l'été, Gobert, blessé cette année à un genou et à une cheville, séjourne dans une clinique californienne pour se réparer et se préparer à la nouvelle saison. Une obligation qui a officiellement provoqué son forfait pour l'Euro 2017.
Super mégalo ?
Le coiffeur venu à son domicile hier soir lui a rasé la tignasse et dessiné un Z dans les cheveux. Rudy est pressenti pour décrocher le titre de « best defensor of the year », une consécration à 24 ans et après seulement quatre saisons de NBA. Grâce à ses statistiques de folie, les Jazz se sont qualifiés pour les play-offs, une première depuis 2012. Les journalistes américains l'adorent pour son accent français et son anglais courant, son sens de la répartie et sa franchise. Quand ils lui demandent s'il voterait pour lui comme meilleur défenseur de l'année, il répond : « Je regarderai de près mais oui, je crois bien… » En mars, le pivot des Jazz avait critiqué, sans nommer personne, certains de ses coéquipiers après une défaite contre les Clippers de Los Angeles. Il s'excusera par la suite. « Je n'ai sans doute pas bien choisi mes mots. » Son coéquipier George Hill : « C'était peut-être un peu immature de sa part. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas laver son linge sale en public. » Du haut de ses 218 sélections (48 pour Gobert) et de ses 16 saisons en NBA, Boris Diaw, capitaine de l'équipe de France, qui évolue lui aussi au sein des Jazz, n'a pas non plus apprécié. Gobzilla aurait-il chopé la grosse tête ? « Disons qu'il se situe dans le spectrum : ni Mère Teresa, c'est sûr, ni Super-Mégalo ! »
Le vestiaire des Jazz embaume le savon et le parfum pour homme. Chacun dispose de son casier surmonté de son numéro, avec sa petite penderie et son siège à roulettes comme chez Ikea. Le match vient de s'achever, les Jazz ont gagné. Diaw, alias « le Président », médite sur l'avenir de la star montante du meilleur championnat de basket-ball au monde : « Rudy a énormément progressé. Il a grandi, sur le terrain et en dehors. Mais il doit améliorer la concentration, le shoot extérieur, qui ne fait pas encore partie de son jeu, ça viendra avec le temps. Et le jeu dos au panier. S'il y arrive, il deviendra alors un joueur vraiment redoutable. » Le meilleur, comme le souhaite Rudy, qui ambitionne de devenir « une superstar, celui qui porte son équipe » ? « Pourquoi pas ? L'erreur serait de brûler les étapes mais jusqu'ici, il ne l'a jamais fait. » On pardonne beaucoup à l'ambitieux et fougueux pivot. « Rudy est unique, assure Igor Kokoškov, un des entraîneurs adjoints des Jazz. C'est un pilier, l'ancre défensive de cette équipe. Il est passionné, il doit juste admettre qu'il ne peut pas vouloir tout, tout de suite. Il y a deux Rudy, en fait : un en dehors de la salle, posé et sérieux ; un autre sur le parquet, qui ne connaît pas le calme. »
Si le match du jour vient d'être remporté par les Jazz, c'est en grande partie grâce à lui. Il sort des vestiaires en empereur glorieux vêtu de son élégant costume, signe quelques autographes, retrouve sa mère dans la salle réservée aux proches des joueurs, croise Alex Jensen, l'un des coachs adjoints qui montre du doigt Corinne Gobert : « C'est elle le vrai coach ! C'est elle qui lui a donné confiance en lui. D'habitude, les très grands souffrent d'un gros complexe. Corinne a réussi à faire en sorte qu'il n'en souffre pas. Tu sens aussi qu'il a reçu une bonne éducation, avec des valeurs, ce qui va l'empêcher de péter les plombs avec tout cet argent. “He'll be fine !” Je ne me fais pas de soucis pour lui. »
Il devrait donc continuer d'épauler les meubles Gautier à Cholet, sponsor historique du club qui a cru en lui quand il n'avait que 17 ans. Thierry Chevrier : « Ce garçon ne changera pas. Il est surhumain. Surhumain d'y être parvenu, d'être à l'aise devant un auditoire de 400 personnes quand il revient à Cholet, et d'être capable de rester lui-même. “Sky is the limit”, comme disent les Américains. Il n'a pas de limite. » Il continuera de progresser tout en aidant discrètement les Restos du cœur et le Secours populaire, sans délaisser son camp d'entraînement pour gamins à Saint-Quentin accessible à des tarifs plus que raisonnables. Et, peut-être, si le projet aboutit, permettre la construction d'un gymnase aux normes parasismiques en Haïti. Tous en sont persuadés : même millionnaire, Gobert n'imitera pas ces jeunes gens à qui l'argent a fait tourner la tête et détruit la carrière. « Tu sais, confie-t-il, je réfléchis toujours pour la plupart des achats. Je me dis “non, c'est pas raisonnable”, alors qu'en fait, c'est bon. Mais c'est un réflexe. »
Plutôt « comme les autres »
Kalem Mauvois : « Un signe parmi d'autres, Rudy ne s'est acheté qu'une voiture. Un beau Range, certes, mais une seule. Les mecs habituellement en possèdent cinq, dont ils ne savent pas quoi faire. » Au restaurant italien où il dîne avec nous après le match, il partage l'addition. Le patron, Don Giuseppe, le prend dans ses bras du mieux qu'il le peut. Les regards se tournent vers la star, aimable, polie avec les serveurs à qui il laissera un généreux pourboire. Il s'autorise quelques gouttes pétillantes d'un Moscato, un pavé de bœuf surmonté d'un mini-bloc de foie gras mi-cuit et un risotto. Sans jamais, à aucun moment au cours du repas, lâcher son portable de la main gauche, hypnotisé par Twitter et les nombreux commentaires sur lui et sur le match. Boris Diaw a beau lui répéter : « Tu t'en fous de tout ça, c'est des conneries », il est happé par la lecture démultipliée des 140 signes et n'écoute plus les questions. Le lendemain, il s'envolera à bord du jet privé des Jazz pour affronter Tony Parker à San Antonio. « Je suis parti de rien, ça n'a pas été facile, mais je reste quelqu'un comme les autres. Même si je suis un des meilleurs au monde dans ce que je fais. » Une pause. « En fait, je le tournerais plutôt comme ça : je suis quelqu'un comme les autres mais qui ne vit pas comme les autres. C'est bien dit, non ? »
Source : Peoplenolimit
Autres actualités

Des nouvelles de : Angel Rodriguez se montre face aux USA

Des nouvelles de : ITW Nicolas De Jong - "Je ne regrette absolument pas d'être parti"